L'arrêt Arrighi (CE, 6 nov. 1936) est l'un des grands arrêts du droit administratif puisqu'il s'agit de l'arrêt qui a consacré la théorie de la loi-écran. En vertu de cette théorie, le juge administratif ne s'estime pas compétent pour contrôler la conformité d’un règlement à la Constitution lorsque le règlement a été pris conformément à une loi.
En effet, rappelons qu'on distingue 2 types de règlements :
- les règlements autonomes, qui sont édictés en dehors de toute loi
- les règlements d'application, qui complètent les lois quand elles nécessitent plus de détails
Ainsi, certains règlements peuvent être pris sur le fondement d'une loi. Dès lors, contrôler la constitutionnalité d'un tel règlement reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi qui lui sert de fondement. Or le contrôle de constitutionnalité de la loi est une prérogative dévolue au Conseil constitutionnel. Ainsi, on considère que la loi « fait écran » entre le règlement et la Constitution, et que le juge administratif ne peut se prononcer sur l'éventuelle inconstitutionnalité du règlement.
Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous intéresser plus en détails à l'arrêt Arrighi.
Les faits de l'arrêt Arrighi
Le sieur Arrighi a été mis à la retraite d'office par le ministre de la guerre en application de l'article 2 du décret du 10 mai 1934 selon lequel « pourront être mis à la retraite d'office, avec droit à pension d'ancienneté, les fonctionnaires justifiant d'un nombre d'années de service au moins égal au minimum exigé et qui seront, du fait de leur admission à la retraite d'office, dispensés de la condition d'âge ».
Le sieur Arrighi avait en effet effectué 30 ans de service et remplissait donc les conditions pour être mis à la retraite d'office. Néanmoins, il conteste sa mise à la retraite.
Les thèses en présence
Le sieur Arrighi invoque différents moyens afin que le juge fasse droit à sa demande.
D'abord, il soutient que l'article 2 du décret du 10 mai 1934 ne lui est pas applicable car il n'a pas accompli 30 ans de services depuis qu'il a quitté l'armée.
Il soutient également que le gouvernement ne disposait pas des pouvoirs pour prendre le décret du 10 mai 1934. En effet, ce décret avait été pris en application de l'article 36 de la loi du 28 février 1934 autorisant le gouvernement à prendre les mesures d'économie exigées par l'équilibre du budget. Plus précisément, la loi du 28 février 1934 était une loi d'habilitation autorisant le gouvernement à prendre des décrets-lois dans ce domaine relevant normalement de la loi. Le recours aux décrets-lois était une pratique courante sous la IIIème République, période durant laquelle se sont déroulés les faits de l'arrêt Arrighi. Ainsi, le décret du 10 mai 1934 était un décret-loi aux fins de mise à la retraite anticipée des fonctionnaires en surnombre. Mais selon le sieur Arrighi, l'article 36 de la loi du 28 février 1934 n'avait pas pour autant autorisé le gouvernement à modifier les règles concernant la mise à la retraite des fonctionnaires. Ainsi, selon lui, le gouvernement avait ici outrepassé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 36 de la loi du 28 février 1934.
Surtout, le sieur Arrighi invoque l'inconstitutionnalité de l'article 36 de la loi du 28 février 1934 (en vertu duquel, on le rappelle, a été pris le décret du 10 mai 1934). Or si cet article 36 était contraire à la Constitution, il devrait être abrogé et le décret du 10 mai 1934 n'aurait alors plus de fondement, entraînant l'invalidité de la mise à la retraite du sieur Arrighi.

Téléchargez 20 fiches de droit administratif pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.
Le problème de droit
Le Conseil d'Etat devait donc répondre à la question suivante :
Dans l'hypothèse d'un règlement pris en application d'une loi et dont le contenu, strictement conforme à cette loi, serait contraire à la Constitution, le Conseil d'Etat est-il compétent pour contrôler la constitutionnalité de ce règlement ?
La solution de l'arrêt Arrighi
Dans son arrêt Arrighi, le Conseil d'Etat écarte le moyen tiré de l'inapplicabilité au sieur Arrighi de l'article 2 du décret du 10 mai 1934 au motif que la durée de service comprend le cumul des services militaires et civils. A ce titre, le sieur Arrighi ayant bien accompli plus de 30 ans de services civils et militaires, il doit se voir appliquer l'article 2 du décret du 10 mai 1934.
Il écarte également le moyen tiré de l'absence d'autorisation du gouvernement pour prendre le décret du 10 mai 1934 en affirmant que l'article 36 de la loi du 28 février 1934 a autorisé le gouvernement à réaliser toutes les réformes susceptibles de conduire à une réduction des charges financières de l'État et d'aider au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 36 de la loi du 28 février 1934 en modifiant, dans un intérêt d'économie, la législation relative à la mise à la retraite des fonctionnaires.
Surtout, le Conseil d'Etat affirme que :
"Sur le moyen tiré de ce que l'article 36 de la loi du 28 février 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avril et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles :
Considérant qu'en l'état actuel du droit public français, ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'État statuant au contentieux."
Ce faisant, le Conseil d'Etat ne s'estime pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un règlement si ce règlement a été pris en application d'une loi. C'est la consécration de la théorie de la loi-écran ; compte tenu de la présence entre la norme constitutionnelle et le règlement d'un « écran législatif », le Conseil d'Etat ne peut contrôler la constitutionnalité du règlement puisque cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi, ce qui ne relève pas de sa compétence. Ainsi, un règlement contraire à la Constitution, mais conforme à une loi qui en constitue le fondement, ne peut être invalidé par le juge administratif.
En conséquence, la requête du sieur Arrighi est rejetée, et le décret du 10 mai 1934 reste en vigueur.
Il faut toutefois préciser que cette décision du Conseil d'Etat s'explique par le contexte de l'époque. Sous la IIIème République, le légicentrisme était en effet la doctrine dominante.
A ce titre, le commissaire du Gouvernement Latournerie n'avait pas hésité à affirmer dans ses conclusions sur l'arrêt Arrighi que :
"Quelque atteinte qu’aient pu recevoir certaines idées trop absolues sur la souveraineté de la loi, il n’en reste pas moins en effet que, dans la théorie et aussi dans la pratique de notre droit public, le Parlement reste l’expression de la volonté générale et ne relève à ce titre que de lui-même et de cette même volonté."
Autrement dit, la loi était considérée comme la seule expression de la souveraineté et disposait d'une autorité suprême dans le système normatif français. Cela explique que le Conseil d'État refuse de contrôler la constitutionnalité de la loi puisque ce faisant, il s'érigerait en censeur de l'expression de la volonté générale.
Ainsi, le commissaire du Gouvernement Latournerie évoquait dans ses conclusions que "si large qu’ait été en effet l’extension des pouvoirs du juge dans l’interprétation de la loi, elle ne saurait aller jamais jusqu’à priver de force un acte législatif, du moins émanant du parlement", et qu'un contrôle de la loi risquerait de compromettre l'acquis de la jurisprudence en remettant en cause la place même du Conseil d'État dans les institutions.
La portée de l'arrêt Arrighi
La théorie de la loi-écran consacrée par l'arrêt Arrighi a par la suite été réaffirmée dans différents arrêts du Conseil d'Etat. Lorsque le requérant soulevait le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi, il obtenait toujours la même réponse :
- « considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'État statuant au contentieux d'apprécier la conformité d'une loi à un principe de valeur constitutionnelle ; que par la suite le moyen doit être écarté… » (CE 28 juill. 1999, Griesmar ; CE 18 nov. 2009, Cté d'agglo Perpignan Méditerranée)
- « considérant que l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu'il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'État lors de l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application » (CE 5 janv. 2005, Deprez et Baillard)
Ainsi, en vertu de l'arrêt Arrighi et de la théorie de la loi-écran, il était permis d'appliquer une loi pourtant contraire à la Constitution.
L'arrêt Arrighi a toutefois été remis en cause, particulièrement suite à l'arrêt Nicolo (CE, 20 octobre 1989, Nicolo) par lequel le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent pour écarter l'application d'une loi contraire à un traité international. Ainsi, la hiérarchie des normes était respectée lorsque la loi contrevenait à un traité international, mais pas lorsque la loi était contraire à la Constitution, alors même que la Constitution est située au sommet de la hiérarchie des normes. Ce paradoxe s'explique d'autant plus mal que c'est la Constitution elle-même, en son article 55, qui confère aux traités internationaux « une autorité supérieure à celle des lois ».
En outre, bon nombre de libertés et de droits consacrés par les normes constitutionnelles le sont aujourd'hui également par des traités internationaux liant la France. Ainsi, la protection offerte par les traités internationaux en matière de droits fondamentaux est plus ou moins équivalente à celle offerte par les normes constitutionnelles. Par conséquent, depuis l'arrêt Nicolo, si un règlement pris en application d'une loi est contraire à la Constitution, le juge administratif peut tout de même en écarter l'application. Il lui suffit, plutôt que d'en contrôler la conformité à la Constitution, d'en vérifier la compatibilité avec les traités internationaux.
Surtout, il faut remarquer que dans l'arrêt Arrighi, le Conseil d'Etat précise qu'il ne peut contrôler la constitutionnalité de la loi "en l'état actuel du droit public français". En effet, en 1936, il n'existait pas de véritable contrôle de constitutionnalité des lois (et donc pas de contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori). Mais depuis le 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), tout justiciable peut contester devant le juge administratif (et le juge judiciaire) la constitutionnalité d’une loi s'il estime que cette loi "porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit" (article 61-1 de la Constitution). Si la QPC est posée devant une juridiction administrative, elle est transmise au Conseil d’Etat, qui la transmet ensuite au Conseil constitutionnel si elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Ainsi, depuis le 1er mars 2010, si un règlement pris en application d'une loi est potentiellement contraire à la Constitution, il faut simplement qu’une QPC soit soulevée et le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. A ce stade, deux possibilités existent :
- Soit la loi est conforme à la Constitution : dans ce cas, le règlement pris en application de cette loi l’est aussi.
- Soit la loi n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, la loi est abrogée et ne peut plus servir de fondement au règlement. En conséquence, le règlement ne peut être appliqué dans l'instance ayant justifié la QPC, pas plus que dans d'autres instances ultérieures.
Dès lors, si le Conseil d'Etat ne contrôle pas directement la constitutionnalité du règlement pris en application de la loi, il intervient tout de même de manière indirecte puisqu'il joue un rôle de filtre dans la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel. Cette QPC pouvant déboucher sur l'abrogation de la loi servant de fondement au règlement, la portée de l'arrêt Arrighi a été réduite depuis l'instauration de ce mécanisme.
L'arrêt Arrighi en vidéo

Téléchargez 20 fiches de droit administratif pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.



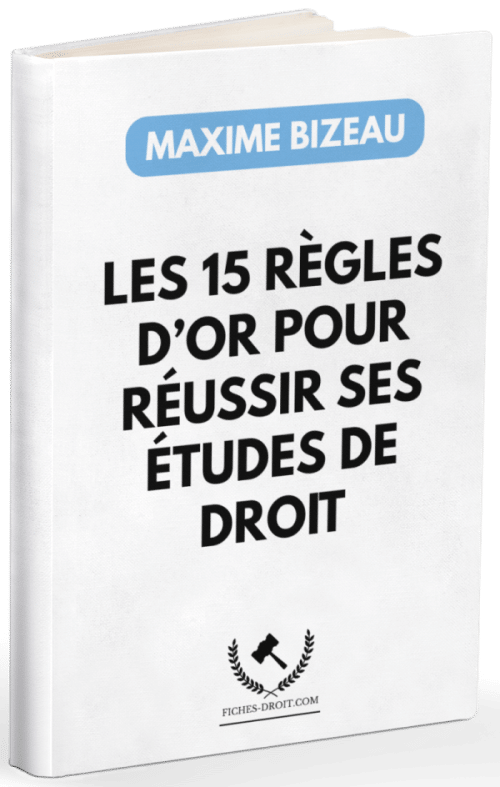
Merci beaucoup pour ce document,ça m’a énormément aidé à comprendre le droit administratif