Définition de la responsabilité du fait des choses
La responsabilité du fait des choses est l'obligation de réparer le dommage résultant du fait des choses dont on a la garde.
Le fondement de la responsabilité du fait des choses est l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses suppose donc qu'un dommage soit causé par le fait d’une chose dont on a la garde.
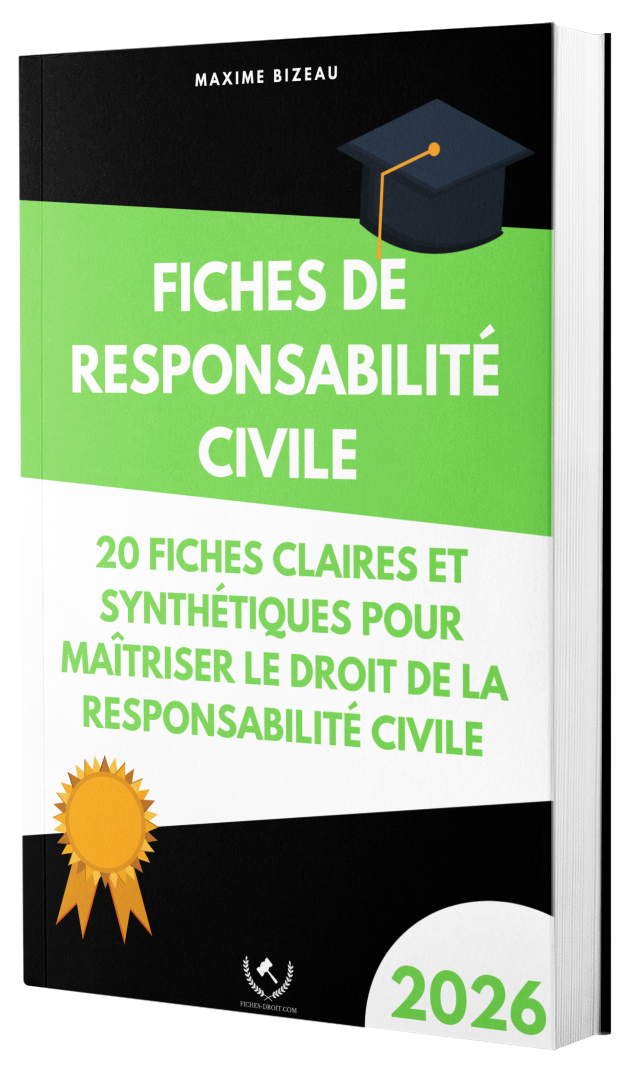
Téléchargez 20 fiches de responsabilité civile pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.
Les conditions de la responsabilité du fait des choses
Il existe 4 conditions pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses :
- un dommage
- une chose
- un fait actif de la chose
- la garde de la chose
Lorsque les 4 conditions ci-dessus sont remplies, la responsabilité du gardien de la chose est engagée ; ce dernier doit indemniser la victime.
Un dommage
Pour engager la responsabilité du gardien de la chose, la victime doit avoir subi un dommage.
Le dommage peut se définir comme l’atteinte subie par la victime dans son corps, dans son patrimoine ou dans ses droits extrapatrimoniaux.
A noter : On parle indifféremment de dommage ou de préjudice ; ces deux termes sont synonymes.
Ainsi, le dommage peut être constitué par :
- une atteinte à l'intégrité physique de la victime. On parle de préjudice corporel. Exemple : une blessure.
- une atteinte au patrimoine de la victime, c'est-à-dire à ses intérêts patrimoniaux ou économiques. On parle de préjudice matériel. Exemple : la destruction d’un bien de la victime.
- une atteinte aux droits ou intérêts extrapatrimoniaux de la victime. On parle de préjudice moral. Exemple : la perte d’un proche.
Une chose
La responsabilité du fait des choses suppose d'être en présence d'une chose.
Le principe est que toutes les choses peuvent être sources de responsabilité, qu'elles soient meubles ou immeubles (exemples : arbres, falaises…), matérielles ou immatérielles (exemples : ondes sonores, vapeur, images télévisées…), inertes ou en mouvement, viciées ou pas, dangereuses ou non.
Ainsi, même une chose qui ne présente absolument aucun caractère de dangerosité peut entrer dans le champ d'application de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. On peut citer un exemple parlant : celui de la feuille de salade qui provoque la chute d’une cliente dans un hypermarché (TGI Montpellier, 13 déc. 2010).
Toutefois, il existe des exceptions à ce principe. Ainsi, l'application de la responsabilité du fait des choses est impossible pour :
- le corps humain, car celui-ci n’est pas considéré comme une chose. Cependant, la jurisprudence applique parfois l’article 1242 alinéa 1 du Code civil à un dommage causé par le corps humain lorsque ce dernier constitue un tout avec la chose. Exemple : un choc entre deux cyclistes (Cass. Crim. 21 juin 1990). Ici la responsabilité du fait des choses sera applicable au corps humain car ce dernier constitue un tout avec le vélo, qui est bien évidemment une chose.
- les choses sans maître ou res nullius (exemples : l’eau, l’air, la neige…) et les choses abandonnées ou res derelictae (exemple : les déchets), car elles n’ont pas de gardien.
- les choses soumises à un régime particulier. Exemples : les animaux (article 1243 du Code civil), les bâtiments en ruine (article 1244 du Code civil), les véhicules terrestres à moteur (loi du 5 juillet 1985), les produits défectueux…
Un fait actif de la chose
La responsabilité du fait des choses suppose également que le dommage ait été causé par un fait actif de la chose.
Cela signifie que la chose doit être l'instrument du dommage, qu'elle doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage (Cass. Civ., 19 févr. 1941, Dame Cadé).
Le rôle actif de la chose s'entend du caractère anormal de la chose dans sa position (exemple : dans un supermarché, la feuille de salade ou la peau de banane qui est sur le sol), son état (exemple : un escalier glissant) ou son fonctionnement.
On comprend donc qu'une chose ne peut pas être source de responsabilité si elle est dans une position normale, dans un état normal et fonctionne normalement. A ce moment-là, elle n'aura en effet joué aucun rôle actif dans la survenance du dommage. Il n'y aura pas eu de fait actif de la chose puisque la chose n'aura fait que subir l'action étrangère de la victime.
En ce qui concerne la preuve de ce rôle actif, il faut distinguer plusieurs hypothèses :
- si la chose est entrée en contact avec le siège du dommage alors qu’elle était en mouvement : il existe une présomption de rôle actif (Cass. Civ. 2ème, 28 nov. 1984). Cela semble logique car une chose qui était en mouvement et qui est entrée en contact avec la victime a vraisemblablement joué un rôle actif dans la survenance du dommage.
- si la chose était en mouvement mais qu'elle n'est pas entrée en contact avec le siège du dommage : la victime doit rapporter la preuve du rôle actif de la chose, en démontrant le caractère anormal de la chose dans sa position, son état ou son fonctionnement. Par exemple, le skieur qui chute à cause d'un autre skieur qui lui a coupé la route (mais qui ne l'a pas touché) doit prouver le rôle actif de la chose (Cass. Civ. 2ème, 3 avril 1978).
- si la chose était inerte (absence de mouvement) : ce sera également à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose, en démontrant le caractère anormal de la chose dans sa position, son état ou son fonctionnement (Cass. Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 22-12.162).
La garde de la chose
La garde de la chose peut se définir comme le pouvoir de fait exercé sur la chose. Le gardien est celui qui a la garde matérielle de la chose, c’est-à-dire l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Mais il s’agit seulement d’une présomption simple : le propriétaire peut renverser cette présomption (et donc s’exonérer de sa responsabilité) en prouvant qu’il n’avait plus l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage (exemples : il avait prêté la chose à une autre personne, ou bien la chose lui a été volée...).
En ce qui concerne la détermination du gardien de la chose, il convient d'apporter plusieurs précisions.
D'abord, le discernement n’est pas une condition pour être gardien de la chose. Par exemple, un enfant peut être gardien de la chose (Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, Gabillet).
Ensuite, une chose n'a en principe qu'un seul gardien. Mais la jurisprudence admet parfois qu’il puisse y avoir plusieurs gardiens en raison d’une garde collective. Il faut que les différents gardiens exercent des pouvoirs identiques sur la chose (Cass. Civ. 2ème, 20 nov. 1968), et qu’il n’existe aucune hiérarchie entre eux (Cass. Civ. 2ème, 8 mars 1995). La victime peut alors engager la responsabilité in solidum des différents gardiens ; chacun des gardiens pourra être tenu d’indemniser la victime. Exemple : dans le cas d’un accident de chasse avec impossibilité de déterminer le tireur, les chasseurs verront leur responsabilité engagée in solidum.
Enfin, la jurisprudence distingue parfois entre la garde de la structure et la garde du comportement (Cass. 5 janv. 1956, Oxygène Liquide) pour déterminer le gardien de la chose :
- Lorsque le dommage est dû à la structure de la chose, c’est-à-dire à ses vices internes, à la manière dont elle a été constituée, c’est le fabricant qui sera considéré comme le gardien.
- Lorsque le dommage est dû au comportement de la chose, c’est-à-dire à la manière dont elle a été utilisée, c’est le détenteur, l’utilisateur de la chose, qui sera considéré comme le gardien.
A noter : Pour de plus amples développements sur la garde de la chose, je vous invite à consulter mon article spécialement dédié à ce sujet, avec notamment une analyse de l'arrêt Franck du 2 décembre 1941. Cliquez ici pour consulter l'article.
Le régime de la responsabilité du fait des choses
Une responsabilité de plein droit
Depuis les arrêts Teffaine et Jand'heur, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit ; elle ne requiert donc aucune faute pour être engagée. Dès lors, il suffit que les 4 conditions ci-dessus soient remplies pour que la responsabilité du gardien de la chose soit engagée.
De même, le gardien ne peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute.
Les causes d'exonération
Le gardien ne peut s’exonérer qu’en prouvant que le dommage est dû à une cause étrangère.
Une cause étrangère est un évènement qui est étranger au gardien et qui a causé le dommage, dans le sens où sans cette cause étrangère, le dommage ne se serait pas produit.
Les causes étrangères sont :
- le cas fortuit : il s’agit d’un évènement extérieur au gardien, imprévisible et irrésistible (présentant donc les caractères de la force majeure). Exemples : une catastrophe naturelle, une grève, un attentat.
- le fait d'un tiers : il s’agit du cas où un tiers a participé à la réalisation du dommage.
- la faute de la victime : il s’agit du cas où la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage.
Parmi ces trois causes étrangères, certaines exonèrent totalement le gardien de sa responsabilité (il n’aura pas à indemniser la victime) tandis que d’autres ne l’exonèrent que partiellement (l’indemnisation de la victime sera diminuée). Ainsi :
- Le cas fortuit donne lieu à une exonération totale de responsabilité pour le gardien.
- Le fait d'un tiers donne lieu à une exonération totale de responsabilité s'il présente les caractères de la force majeure. S'il ne présente pas ces caractères, il ne donne lieu à aucune exonération de responsabilité. Le gardien et le tiers sont alors responsables in solidum ; la victime pourra obtenir l’entière réparation de son préjudice en agissant contre un seul d’entre eux.
- La faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure donne lieu à une exonération totale de responsabilité tandis que la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure donne lieu à une exonération partielle de responsabilité.
Cas fortuit | Exonération totale |
Fait d'un tiers | Absence d’exonération (le gardien et le tiers sont responsables in solidum) Exonération totale si présente les caractères de la force majeure |
Faute de la victime | Exonération partielle Exonération totale si présente les caractères de la force majeure |
La responsabilité du fait des choses en vidéo
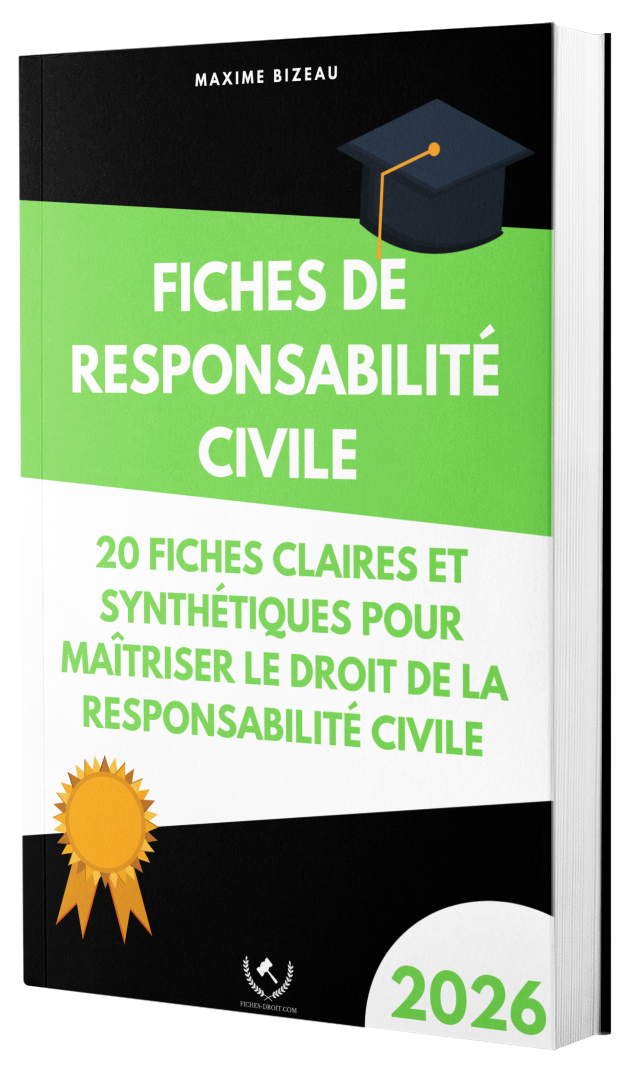
Téléchargez 20 fiches de responsabilité civile pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.



Cher Maxime,
Vieil OPJ retraité je viens ce jour d’être amené à me repencher sur la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde à la réception de ma facture d’eau à laquelle est joint un nouveau règlement appelé à se généraliser et qui pourrait devenir le sujet d’une réflexion juridique.
L’objet de ce règlement est lié à la volonté de l’opérateur, en l’occurence Suez, de déployer des compteurs communicants par radio-fréquences. Deux points m’interpellent en particulier :
– 1 – Ce règlement prétend empêcher les abonnés de neutraliser la télé-relève alors qu’on pourrait considérer qu’il s’agit de légitime défense de sa santé et de celle d’autrui puisque toutes les études indépendantes montrent la dangerosité des ondes et que plusieurs recommandations tant européennes que nationale invitent à diminuer l’impact des ondes.
-2- Et cerise sur le gâteau, pour ce faire il entend nous instituer gardien de la chose au sens de l’article 1384 qui figure dans le document alors qu’il est modifié depuis deux ans.
Or un abonné sensé ne peut que refuser de devenir gardien d’une chose par nature dangereuse, d’autant plus qu’aucune assurance ne couvre désormais les conséquences des ondes électromagnétiques.
J’ai des armes et la loi m’impose de prendre les dispositions pour qu’elles ne puissent présenter un danger en cas d’utilisation non autorisée ; elles sont donc sous clefs et sous mon contrôle.
Le compteur émissif de fréquences nocives est d’autant moins sous mon contrôle que le dit règlement prétend m’empêcher de le neutraliser par enveloppement d’aluminium par exemple.
– 3 – le même texte laisse clairement entendre que son refus est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat, ce qui à mon humble avis n’est pas possible, d’une part parce que l’eau est une nécessité élémentaire et d’autre part en vertu de différents textes sur la consommation et maintenant sur le RGPD qui exclue que la fourniture d’un service soit conditionnée à l’acceptation de prélèvements de nos données personnelles.
Je suis convaincu que ce sujet va s’imposer dans les mois ou années qui viennent et il n’est pas interdit de prendre un peu d’avance car c’est une question d’intérêt général que bafouent actuellement tous les opérateurs au préjudice de la population.
Je vous souhaite une bonne continuation et bravo pour l’initiative qui facilite la vie des étudiants en droit. J’aurai aimé cela dans ma jeunesse.
Bien cordialement.
Jean-Louis.