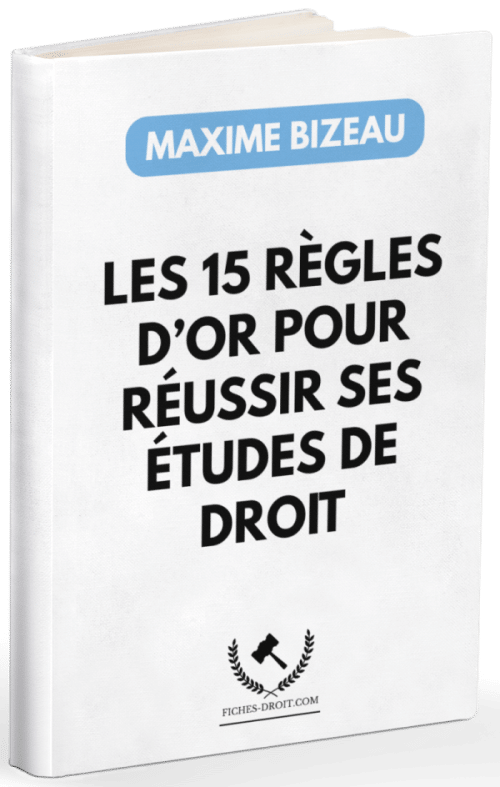Vous trouverez ci-dessous un exemple de cas pratique en droit administratif. Ce cas pratique a été réalisé par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Bordeaux. Elle a obtenu la note de 17,5/20.
Bonne lecture !
Énoncé du cas pratique
Les déboires de Léon, notre jeune entrepreneur de tourisme durable aux convictions pro-animalières bien trempées, n’en finissent pas. A la suite de la manifestation géante contre la chasse à courre, à laquelle il s’était joint avec enthousiasme, mais qui avait dégénéré en raison de la présence de nombreux chasseurs, le Maire de la Ville de Bordeaux a décidé de réagir afin de ramener un peu de calme dans une bourgade connue pour sa modération. Profitant de la promulgation d’une nouvelle loi – dont il se targue d’être à l’origine puisque le Premier ministre est un de ses plus proches amis -, le Maire décide d’interdire, dans le périmètre communal, toutes les manifestations jusqu’à nouvel ordre. Léon est scandalisé et décide d’intenter différentes actions. Il vous sollicite à nouveau.
1. – (6 points) Cette interdiction a été édictée par un arrêté du Maire en date du 10 mars 2022, pris en application d’une loi du 1er mars 2022, entrée immédiatement en vigueur, qui a modifié les articles L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure, relatifs à la réglementation des manifestations sur la voie publique. Désormais, non seulement les manifestations sont soumises à un régime d’autorisation préalable (et non plus de déclaration) en mairie, mais surtout l’autorité de police administrative peut les interdire pour une longue durée (la mention de “troubles à l’ordre public” disparaît). Léon pense que cet arrêté qu’il juge liberticide, est contraire à la liberté d’expression protégée tant par la Constitution, que par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il souhaite contester cet acte devant le juge administratif. Quel type de recours peut-il faire ? (2 points) Se souvenant vaguement de son cours de droit administratif, il craint cependant que la loi ne soit un obstacle à son recours contre l’arrêté. Qu’en pensez-vous ? Son recours a-t-il une chance d’aboutir ? (4 points)
2. – (7 points) Léon est persuadé que le Maire lui en veut personnellement et qu’il cherche tous les moyens pour le faire “plier”. La preuve en est, selon lui, qu’il a pris un arrêté le 12 mars 2022 qui lui a été notifié, ordonnant, dans les six mois, l’euthanasie de son chien, Léonard, qui avait mordu à plusieurs reprises des chasseurs lors de la grande manifestation. Le maire se fonde sur une disposition du code rural et de la pêche maritime qui détermine l’étendue de ses pouvoirs de police spéciale face aux animaux potentiellement dangereux. Léon souhaite évidemment contester cet arrêté. Une vielle amie, Nicole Holut, très au fait du droit animalier, lui signale l’existence d’une directive de l’Union européenne, publiée le 15 janvier 2022, qui a pour objectif de protéger les animaux de compagnie et qui interdit aux Etats de procéder à leur euthanasie, sauf pour d’impérieuses raisons vétérinaires. Le problème est que cette directive n’a pas encore été transposée. Léon s’interroge : peut-il encore sauver son compagnon ? (3 points)
Léonard a encore quelques semaines de sursis. En attendant, il ne déroge pas à ses habitudes : il adore se promener seul et ne manque jamais de faire le tour du quartier tous les matins avant de rentrer à la maison pour réveiller son maître. Mais cette liberté risque, elle aussi, d’être compromise : Léon vient d’apprendre que le Maire avait pris un autre arrêté en date du 15 mars 2022, pris sur le fondement de sa police administrative générale, interdisant la divagation des chiens, à l’exception des chiens de chasse. Léon est hors de lui et ne supporte plus cet acharnement. Il souhaite aussi attaquer cet arrêté scandaleux. Il invoque deux arguments. D’abord, l’arrêté ne respecte absolument pas la procédure consultative prévue par une nouvelle loi en date du 21 février 2022 qui impose désormais la consultation des conseils de quartier sur toutes les mesures municipales qui concernent les animaux de compagnie ; ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Ensuite, il estime que, sur le fond, cet acte est complètement disproportionné. Que pensez-vous de ces arguments ? (4 points)
3. – (9 points) Léon aimerait bien aussi obtenir de l’Etat réparation d’un certain nombre de préjudices qu’il estime avoir subi.
D’abord, on se souvient qu’à l’occasion de la grande manifestation de l’année dernière, Léon avait reproché au Maire de ne pas avoir pris, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, un arrêté interdisant la tenue de la réunion publique du polémiste Sacha Assecourt qui avait mis le feu aux poudres. Léon, face à cette inaction, avait alerté la Préfète afin que, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, elle se substitue au maire. La Préfète n’a jamais donné suite. L’Etat n’engage-t-il pas sa responsabilité en cas de carence de son contrôle sur les actes locaux ? Sur quel fondement ? (3 points)
Ensuite, Léon souhaiterait en profiter pour régler un vieux contentieux. Il y a quelques années, ses parents avaient fait l’acquisition d’un pavillon de chasse dans le Médoc, dont il a hérité. Avec quelques-uns de ses amis, il a fait de cette immense propriété un refuge pour tous les animaux destinés à la chasse. Malheureusement, des adeptes de la vènerie s’y sont vite installés, estimant que ce domaine a toujours été un relais pour la chasse à courre. Après des mois de bataille judiciaire, Léon a enfin obtenu du Tribunal judiciaire une ordonnance d’expulsion. Face à la résistance des occupants, Léon a fini par demander à la Préfète le concours de la force publique. Mais cette dernière a explicitement refusé ce concours, en arguant du fait que cette intervention ne ferait qu’exacerber un conflit déjà explosif. Léon ne comprend pas cette situation : l’Etat n’est-il pas tenu d’apporter son concours à l’exécution des décisions de justice ? Sa responsabilité ne peut-elle pas être engagée du fait de cette faute caractérisée ? (3 points)
Enfin, Léon se demande s’il ne pourrait pas obtenir réparation du fait de la loi du 1er mars 2022 qui a modifié la réglementation des manifestations. Dans l’hypothèse où cette loi serait contraire à la Constitution et à la CEDH (ce dont il est persuadé), existe-il une possibilité d’obtenir réparation de l’Etat ? Léon reste dubitatif sur ce dernier point car il se rappelle que les conditions de la responsabilité du fait des lois sont très restrictives. Qu’en pensez-vous ? (3 points)
Cas pratique corrigé
1. A la suite d’une manifestation qui a dégénéré, le Maire de la Ville de Bordeaux a profité de la promulgation d’une loi pour interdire toutes les manifestations jusqu’à nouvel ordre dans le périmètre communal. Cette interdiction a été édictée par un arrêté du 10 mars 2022, pris en application d’une loi du 1er mars 2022, entrée immédiatement en vigueur, qui a modifié les articles L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure. Désormais, les manifestations sont soumises à un régime d’autorisation préalable en mairie et l’autorité de police administrative peut les interdire pour une longue durée. Un administré juge cet arrêté liberticide, en étant contraire à la liberté d’expression protégée tant par la Constitution, que par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il s’agit en l’espèce, d’une part, de la possibilité pour un administré de contester la légalité d’un acte administratif à travers un recours devant le juge administratif et d’autre part, de la compétence du juge administratif pour juger de la constitutionnalité d’un acte administratif pris en application d’une loi.
Ainsi, deux questions se posent :
- quel type de recours peut exercer l’administré afin de contester l’acte administratif ?
- le juge administratif est-il compétent pour exercer un contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité d’un acte administratif pris en application d’une loi ?
a. Le type de recours possible
La décision administrative est un acte modifiant l’ordonnancement juridique, soit dont les effets font suffisamment grief. Aussi, le principe de légalité auquel est soumise l’action administrative désigne un rapport entre deux normes : la norme contrôlée et les normes qui lui sont supérieures. Il existe ainsi en contentieux administratif plusieurs types de recours qui visent à assurer le maintien de ce principe. Par un arrêt du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir permettant de contrôler la légalité administrative de l’acte. Ce type de recours se distingue du recours de plein contentieux qui porte sur la violation d’un droit subjectif.
Conformément à la décision Conseil de la concurrence rendue par le Conseil constitutionnel en 1987, l’annulation et la réformation des décisions mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique relèvent en principe de la juridiction administrative. Elle devra être saisie dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication de l’acte en vertu de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative.
Enfin, concernant les conditions tenant au requérant, ce dernier doit avoir la capacité pour agir mais aussi un intérêt à agir. À titre d’illustration, la qualité de contribuable local donne qualité pour agir (CE, 1901, Casanova).
En l’espèce, un administré souhaite attaquer la légalité d’un arrêté pris par le maire de sa ville qui vise à interdire les manifestations dans le périmètre communal. D’une part, c’est un acte administratif car c’est une décision réglementaire qui met en œuvre ses prérogatives de puissance publique et d’autre part, c’est un acte décisoire. En effet, l’arrêté a pour objet d’interdire toutes les manifestations jusqu’à nouvel ordre dans un périmètre limité, il crée donc une obligation supplémentaire que les administrés se doivent de respecter. Aussi, il ne fait aucun doute que l’administré ait un intérêt à agir car l’arrêté vise à restreindre les manifestations et donc implicitement, il restreint la liberté d’expression consacrée tant par la Constitution, que par la Convention européenne des droits de l’Homme. L’acte administratif peut donc être potentiellement liberticide. Aussi, il peut justifier d’un intérêt eu égard à sa qualité de contribuable communal. En outre, il ne ressort pas des faits que le délai de recours contentieux soit expiré.
Par conséquent, l’administré pourra contester l’arrêté du 10 mars 2022 pris par le maire de sa ville en exerçant un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Cette possibilité d’exercer un tel recours s’éteindra au bout de deux mois si aucune exception de délai n’est faite.
b. Le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité d’un acte administratif pris en application d’une loi
Concernant la contrariété d’un acte administratif avec la Constitution, il a toujours été acquis en droit administratif que le juge administratif puisse imposer à l’administration le respect des dispositions constitutionnelles. Il est donc compétent pour contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif. Ce contrôle a même pu s’étendre à des principes constitutionnels protecteurs des droits contenus dans le préambule de la Constitution de 1946 (CE, 1950, Dehaene). Néanmoins, si le juge administratif reconnait valeur constitutionnelle à l’ensemble de la Constitution, toutes les dispositions de la norme fondamentale ne sont pas invocables. Pour qu’une norme constitutionnelle soit invocable, il faut qu’elle soit d’applicabilité immédiate, c’est-à-dire suffisamment précise et prescriptive (CE, 1968, Tallagrand). C’est le cas des articles 10 et 11 de la DDHC (CE, 4 nov. 1994, Féd. CGT des services publics).
Il existe des situations où l’acte administratif dont le requérant conteste la constitutionnalité est une simple application de la loi. Dans cette hypothèse, contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif revient alors à contrôler la loi car celle-ci s’interpose dans le contrôle et devient ainsi l’objet du contrôle. Or, le juge administratif s’est très tôt déclaré incompétent pour exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi en vertu de la théorie de la loi-écran (CE, 1936, Arrighi). Cette incompétence s’explique par le fait que le seul contrôle de constitutionnalité de la loi prévu par la Constitution est exercé par le Conseil constitutionnel en vertu de l’article 61 de la Constitution et depuis la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») par l’article 61-1.
Toutefois, le Conseil d’Etat a précisé dans l’arrêt Quintin de 1991 que la théorie de l’écran législatif s’appliquera seulement si le contenu de l’acte administratif est identique à celui de la loi. Si l’acte administratif fait application d’une loi ou est pris sur son fondement mais qu’il ne se contente pas de reprendre simplement les termes de la loi, il s’agit alors de la théorie de l’« écran transparent ». Cela permettra donc au juge administratif d’effectuer un contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif car la seule présence d’une loi entre l’acte administratif et la Constitution ne suffit plus à écarter le contrôle de constitutionnalité du juge administratif. Ainsi, pour que la loi fasse écran, elle doit contenir des règles de fond. Le Conseil d’État dans l’arrêt Fédération nationale de la pêche France du 12 juillet 2013 est venu préciser ses théories en posant une conception plus stricte de l’écran législatif : quand l’acte administratif (décret d’application en l’espèce), tire les conséquences nécessaires des dispositions législatives, la loi fait écran. A défaut, l’écran est transparent.
Enfin, concernant la contrariété de la loi avec la Convention européenne des Droits de l’Homme, le juge administratif a accepté pour la première fois dans l’arrêt Dame Kirkwood du 30 mai 1952 de reconnaître qu’un acte administratif doit être conforme à un traité. Le juge contrôle ainsi l’application par l’administration du droit international. Cette jurisprudence s’est par la suite étendue à la Convention européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Belgacem du 19 avril 1991. En outre, le juge administratif contrôle également la conventionnalité des lois (CE, 1991, Nicolo).
En l’espèce, l’arrêté d’interdiction met en cause le droit de manifestation et corrélativement la liberté d’expression consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, l’invocabilité sera variable en fonction de la norme concernée (interne ou externe).
S’agissant des normes constitutionnelles, il convient de souligner que l’arrêté d’interdiction a été pris en application du nouvel article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure dans sa version issue de la loi du 1er mars 2022. En l’occurrence, cet article pose expressément la faculté pour l’autorité de police administrative d’interdire des manifestations pour une longue durée. En outre, les manifestations sont désormais soumises à un régime d’autorisation préalable. Il en résulte qu’au regard des faits exposés, l’arrêté semble se borner à tirer les conséquences nécessaires de cette loi qui a fait disparaître le motif de troubles à l’ordre public. La loi faisant écran entre l’acte administratif et la Constitution, la méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (ci-après DDHC) ne pourra être invoquée qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
S’agissant de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, Léon peut soulever sa méconnaissance tant par l’arrêté que par la loi du 1er mars 2022 en application des jurisprudences Belgacem et Nicolo précitées.
Par conséquent, il est hautement probable que la loi-écran fasse obstacle au moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la DDHC par l’acte administratif. Cette contrariété ne pourra être soulevée qu’à l’appui d’une QPC au regard des faits de l’espèce. Toutefois, les moyens tirés de l’inconventionnalité de l’arrêté et de la loi pourront être recevables.
2.a. Un maire a pris un arrêté le 12 mars 2022 ordonnant à un administré l’euthanasie de son chien. Cet arrêté se fonde sur une disposition du Code rural et de la pêche maritime qui détermine l’étendue des pouvoirs de police spéciale des maires face aux animaux potentiellement dangereux. Il existe toutefois une directive de l’Union européenne, publiée le 15 janvier 2022 mais qui n’a pas encore été transposée, qui a pour objectif de protéger les animaux de compagnie et qui interdit aux Etats de procéder à leur euthanasie, sauf pour d’impérieuses raisons vétérinaires.
Il s’agit en l’espèce d’un administré mécontent d’un acte individuel pris en vertu du pouvoir de police spéciale conféré au maire et qui souhaite donc invoquer une directive de l’Union européenne afin que l’acte soit annulé.
Une question doit donc se poser : Est-il possible pour un administré d’invoquer une directive de l’Union européenne non transposée, à l’appui d’un recours en annulation contre une décision administrative individuelle devant le juge administratif ?
Si le droit de l’Union européenne est, par principe, d’applicabilité directe dans les ordres juridiques internes, tel n’est pas le cas des directives qui doivent faire l’objet d’une transposition en droit national en vertu de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, le juge européen a précisé que les dispositions précises et inconditionnelles des directives non transposées dans le délai imparti produisent des effets directs dans les relations entre les États membres et les particuliers (CJCE, 1974, Van Duyn).
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat refusait l’invocabilité des directives à l’appui d’un recours en annulation d’un acte administratif individuel concernant un ressortissant de l’Union européenne (CE, 1978, Cohn-Bendit). Cette décision a été abandonnée en 2009 (CE, 2009, Dame Perreux). S’alignant sur la Cour de justice, la Haute juridiction administrative pose deux conditions pour qu’une directive non transposée soit invocable à l’appui d’un recours en annulation contre un acte individuel. D’une part, le délai de transposition doit être expiré. D’autre part, les dispositions de la directive invoquée doivent être précises et inconditionnelles ; c’est à dire des dispositions qui se suffisent à elles-mêmes, où les sujets doivent explicitement savoir s’ils bénéficient de droits ou/et ont des obligations découlant de la directive.
En l’espèce, un administré doit euthanasier son chien dans les six mois à venir, sur la base d’un acte administratif individuel pris par le maire. Cet arrêté a été pris sur le fondement de l’article L 211-11 du Code rural et de la pêche maritime : « (…) En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. » Or, une directive de l’Union européenne publiée le 15 janvier 2022, qui a pour objectif de protéger les animaux de compagnie, interdit aux Etats de procéder à leur euthanasie, sauf pour d’impérieuses raisons vétérinaires.
Au cas d’espèce, la date limite de transposition n’est pas précisée. Cependant, il n’apparaît au vu des faits mentionnés que ce délai ait expiré compte tenu de la proximité temporelle entre la publication au 15 janvier 2022 et l’arrêté du 12 mars 2022. En outre, si la disposition de la directive est précise, elle ne semble pas être inconditionnelle eu égard à l’exception d’impérieuses raisons vétérinaires.
Par conséquent, l’administré ne semble pas pouvoir se prévaloir des dispositions de la directive dès lors qu’il est hautement improbable que le délai de transposition de la directive du 15 janvier 2022 ait expiré avant le 12 mars 2022.
b. Un Maire a pris un arrêté en date du 15 mars 2022, pris sur le fondement de sa police administrative générale, interdisant la divagation des chiens, à l’exception des chiens de chasse. Un administré souhaite attaquer cet acte car d’une part, l’arrêté ne semble pas respecter la procédure consultative prévue par une nouvelle loi en date du 21 février 2022 qui impose la consultation des conseils de quartier sur toutes les mesures municipales qui concernent les animaux de compagnie. D’autre part, sur le fond, cet acte semble être disproportionné.
Il s’agit en l’espèce d’un administré qui souhaite attaquer un acte administratif pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale car celui-ci ne semble pas avoir respecté au préalable une procédure administrative non-contentieuse mais aussi car il semble être disproportionnée.
L’administré peut-il faire annuler l’arrêté pris par le maire en contestant devant le juge administratif, juge de l’excès de pouvoir, la légalité externe et la légalité interne de l’acte ?
Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge peut sanctionner différents vices affectant la légalité de l’acte. On distingue les vices de légalité externe et les vices de légalité interne.
La légalité externe correspond à l’environnement de l’acte litigieux. Dans cette hypothèse, le juge sanctionne le fait que l’administration a fait l’impasse sur des formalités ou des procédures prescrites par la loi, en contradiction avec les « procédures administratives non-contentieuses ». Toutefois, conformément à la jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat de 2011 qui tempère les excès de formalisme, un vice de procédure n’est sanctionné que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Autrement dit, il faut que le vice soit « substantiel ».
Concernant les vices de légalité interne qui s’attachent au contenu même de la décision, trois vices sont sanctionnables : celui affectant le but de l’acte (détournement de pouvoir), l’objet de l’acte (violation directe de la loi) et le motif de l’acte (erreur de droit ou erreur de fait). En matière de police administrative, le juge exerce un contrôle maximum dit de proportionnalité en allant au-delà de la qualification juridique des faits. Il va ainsi contrôler l’appréciation ou l’adéquation des faits, c’est-à-dire le choix du contenu de la décision en fonction des motifs de fait. Pour rappel, le Code général des collectivités territoriales prévoit à l’article L. 2212-2 que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ». Les autorités administratives qui disposent donc de ce pouvoir de police peuvent prendre des mesures de police et restreindre certaines libertés afin de maintenir l’ordre public. Il en va ainsi pour le maire (article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales). Le juge vérifie donc que la mesure est bien nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre public et justement proportionnée aux menaces invoquées (CE, 1933, Benjamin). Plus précisément, elles doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées (CE, 2011, Association pour la promotion de l’image). C’est le triple test de proportionnalité. En outre, sont présumées illégales les mesures générales et absolues (CE, 1927, Carlier). Cette présomption peut être renversée si la mesure était nécessaire au regard du trouble (CE, 1968, Epoux Leroy).
En l’espèce, l’autorité administrative n’a pas consulté les conseils de quartier alors que la loi du 21 février impose de les consulter sur toutes les mesures municipales qui concernent les animaux de compagnie. Cette mesure constitue indubitablement un vice de procédure pour défaut de consultation pour un avis obligatoire. En l’occurrence, il est substantiel et permet d’entraîner l’annulation de l’acte. En effet, il a eu une influence sur le sens de la décision car le maire n’a pas pu apprécier correctement la portée de sa décision en l’absence de consultation. En outre, ce défaut de consultation a privé les propriétaires d’animaux de compagnie de faire valoir leurs observations via les conseils de quartier.
Concernant la disproportion de la mesure : en premier lieu, il ne ressort pas des faits de l’espèce qu’il existait un risque de trouble sérieux à l’ordre public. En deuxième lieu, les faits énoncés ne permettent pas d’établir que d’autres mesures moins restrictives ont été instaurées pour atteindre la satisfaction de l’ordre public. En l’occurrence, la mesure est d’ailleurs illimitée dans le temps et dans l’espace. Enfin en troisième lieu, la mesure apparaît manifestement disproportionnée puisqu’elle interdit la divagation de tous les chiens à l’exception des chiens de chasse et pose donc une distinction qui ne semble pas fondée.
Par conséquent, ces vices de légalité, externe comme interne, pourront être invoqués par l’administré qui présentera ces moyens juridiques pour contester la légalité de l’acte, ces moyens constituant des cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir et seront susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte.
3. a. La carence de l’Etat
Un administré avait reproché au Maire de ne pas avoir pris, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, un arrêté interdisant la tenue d’une réunion publique pouvant engendrer des troubles à l’ordre public. Face à cette inaction, il avait alerté la Préfète afin que, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, elle se substitue au maire mais celle-ci n’a jamais donné suite.
Il convient donc de se poser la question suivante : La Préfète, et donc l’Etat, peut-il engager sa responsabilité en cas de carence de son contrôle sur les actes locaux ?
Le maire détient un pouvoir de police administrative générale en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Étant précisé que ce pouvoir se réalise « sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département » en vertu de l’article L. 2212-1 du même code.
Ainsi, en vertu de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ». Ainsi, comme l’a affirmé le Conseil d’Etat, l’Etat peut voir sa responsabilité engagée pour faute lourde en cas de carence du préfet à exercer son pouvoir de substitution d’action (Conseil d’Etat, 29 avril 1987, Ecole Notre-Dame de Kernitron, CE, 25 juillet 2007, Société France Telecom, Société Axa Corporate).
En l’espèce, l’administré a sollicité la Préfète afin qu’elle se substitue au maire en raison de son inaction pour interdire la tenue de la réunion publique de M. Sasha Assecourt. Cette mesure, qui concerne la sûreté et la tranquillité publique, n’a pas été prise par le maire. En outre, l’administré devra démontrer que la Préfète a commis une faute lourde en n’accomplissant aucune diligence ou pas assez, pour faire cesser les troubles. Toutefois, il ne semble pas à la lumière des faits exposés que la Préfète a mis le maire en demeure d’agir. L’administré évoque simplement « qu’elle n’a jamais donné suite ».
Par conséquent, l’administré pourra engager la responsabilité de l’Etat du fait d’une carence de son contrôle sur les actes locaux s’il démontre l’existence d’une faute lourde par le manque de diligences.
b. Le concours de l’administration à l’exécution des décisions de justice
Un administré a mis en place, au sein d’une propriété, un refuge pour les animaux destinés à la chasse. Des adeptes de la vènerie s’y sont installés, estimant que ce domaine a toujours été un relais pour la chasse à courre. Le propriétaire du refuge a fini par obtenir du Tribunal judiciaire une ordonnance d’expulsion. Mais face à la résistance des occupants, il a demandé à la Préfète le concours de la force publique, que cette dernière a refusé au motif que ça ne ferait qu’exacerber un conflit déjà explosif.
Une question doit donc se poser : l’Etat peut-il voir sa responsabilité engagée s’il n’apporte pas son concours à l’exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants de la propriété ?
En vertu de l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Cette obligation peut donc être sanctionnée et le refus de concours de la force publique peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un référé-liberté (CE, 1er juin 2017, SCI La Marne Fourmies).
Le refus peut être légal et entraîner la responsabilité sans faute de l’Etat pour les préjudices présentant un caractère anormal et spécial lorsqu’existent des risques de troubles graves à l’ordre public (CE, 1923, Couitéas). En outre la jurisprudence a synthétisé les motifs justifiant un recours à la force publique pour l’exécution des décisions de justice, « des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier (…) le refus de prêter le concours de la force publique » (CE, 2010, Ben Amour).
En l’espèce, la Préfète argue que l’intervention de la force publique ne ferait qu’exacerber un conflit déjà explosif. Le choix de l’action en responsabilité dépendra de la légalité de ce motif. Il s’agira d’une responsabilité pour faute en cas d’illégalité du refus et d’une responsabilité sans faute en cas de légalité du refus sous réserve de justifier d’un préjudice anormal et spécial.
En l’occurrence, la Préfète tient compte d’un historique conflictuel et contestataire des adeptes de la vénerie pour éviter un nouveau trouble à l’ordre public. Il semble, au regard des faits exposés, qu’il n’y a pas une durée manifestement excessive d’inexécution de la décision de justice puisqu’elle a l’air récente. Le motif de refus paraît donc légal sous réserve d’une appréciation souveraine des juges qui tiendront compte d’éléments extérieurs aux faits énoncés.
Par conséquent, il y a de fortes probabilités que seule une action en responsabilité sans faute soit envisageable, dès lors que le motif de refus de la Préfète paraît légal. Toutefois, l’administré devra justifier d’un préjudice anormal et spécial résultant de ce refus.
c. La responsabilité de l’Etat du fait d’une loi
Un administré se demande s’il peut obtenir réparation du fait de la loi du 1er mars 2022 qui a modifié la réglementation des manifestations, sachant que celle-ci semble contraire à la Constitution et à la Convention européenne des Droits de l’homme.
Il s’agit donc en l’espèce d’un cas de responsabilité du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et plus précisément de la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi.
Il convient de se poser la question suivante : est-il possible pour l’administré d’obtenir réparation de l’Etat du fait de la loi du 1er mars 2022 ?
Quand l’administration prend une décision qui n’est pas illégale mais qui créée une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, en imposant des obligations supplémentaires à certains, elle doit réparer les conséquences dommageables s’il existe un préjudice anormal et spécial. Dans l’arrêt du Conseil d’Etat pris en Assemblée plénière le 14 janvier 1938, SA des Produits laitiers « La Fleurette », les juges ont affirmé que quand la loi fait supporter, en vertu de l’intérêt général, une sujétion particulière à certains citoyens, la responsabilité sans faute de l’Etat vient alors réparer cette rupture d’égalité.
Concernant la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi contraire à une norme externe, l’arrêt Gardedieu pris en Assemblée plénière du 8 février 2007 a affirmé, à propos d’une loi incompatible avec l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques mais aussi qu’elle peut être engagée : « en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. ».
La jurisprudence Gardedieu s’est par la suite étendue à une loi inconstitutionnelle, où, dans trois arrêts d’Assemblée (CE, Ass., 24 déc. 2019, Société Paris Clichy, Société Hôtelière Paris Eiffel Suffren, M. Laillat), le Conseil d’Etat fait une distinction dans la réparation des préjudices nés de l’adoption de la loi et ceux nés de l’application de la loi. La réparation des préjudices nés de l’adoption d’une loi relève d’une responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques tandis que la réparation des préjudices nés de l’application de la loi relève d’une responsabilité de l’Etat qui « en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes » peut être engagée « pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. ». Toutefois, pour que cette responsabilité soit reconnue, il faut que le Conseil constitutionnel ait déclaré préalablement la loi inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution qui vise la question prioritaire de constitutionnalité ou bien que la loi ait été déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 de la Constitution qui vise le contrôle a priori). Enfin, il faut que la décision du Conseil constitutionnel ne s’oppose pas à cette réparation.
En l’espèce, la responsabilité du fait de la loi du 1er mars 2022 s’apprécie différemment selon sa contrariété avec la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution.
En premier lieu, la responsabilité pour méconnaissance d’une norme externe pourrait être reconnue sous réserve que l’administré démontre cette contrariété. En application de l’arrêt Gardedieu, tous ses préjudices pourront être réparés.
En second lieu, si la responsabilité du fait d’une loi inconstitutionnelle a été consacrée par le Conseil d’Etat dans les décisions précitées de 2019, elle est strictement encadrée. Il convient ainsi de distinguer selon que les préjudices résultent des conditions d’adoption de la loi ou de son application. Dans les deux cas, il devra démontrer cette contrariété à la norme constitutionnelle. Le premier cas – sur les conditions d’adoption – est difficilement envisageable. Concernant le second cas – la méconnaissance dans son application – elle est tout aussi difficile. En l’occurrence, la loi est récente et au vu des faits de l’espèce, il ne semble pas que le Conseil constitutionnel ait déclaré les dispositions législatives concernées inconstitutionnelles. Cette condition n’étant pas remplie, la responsabilité du fait d’une loi contraire à la Constitution pour les préjudices nés de son application n’apparaît pas envisageable.
Par conséquent, seule la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi contraire à la Convention européenne des droits de l’homme pourra être envisagée, sous réserve que l’administré démontre que les préjudices subis résultent de cette méconnaissance de la norme externe.
C’est tout pour cet exemple de cas pratique en droit administratif. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos cas pratiques en droit administratif.

Téléchargez 20 fiches de droit administratif pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.